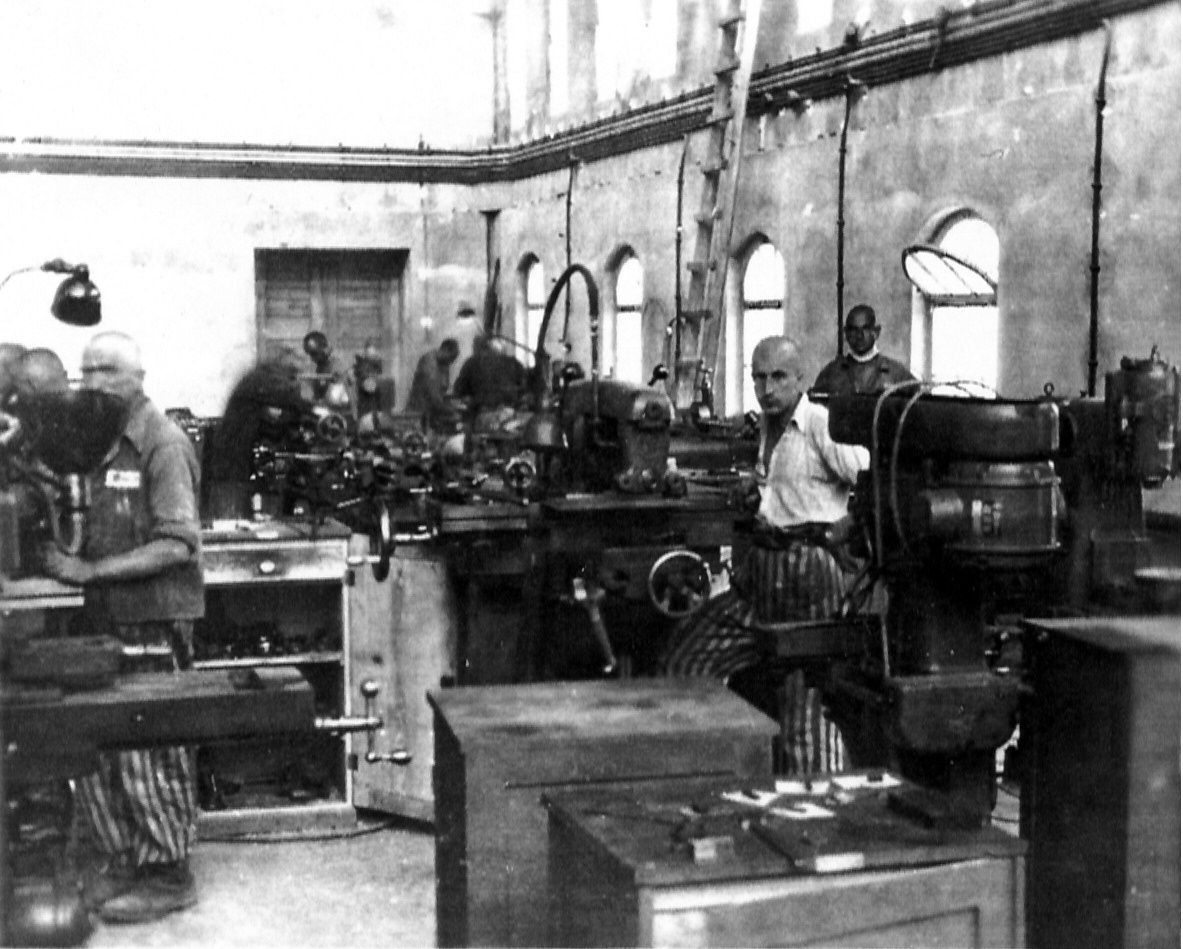La Déportation
Le 25 août 1942, Norbert Sperber, le frère aîné de mon ami Isidore, est venu de Castres à l’improviste. Son frère avait été arrêté la veille par des gendarmes ! Lui, par chance, ne se trouvait pas à la maison, et ses parents, on ne sait pour quelle raison, n’ont pas été inquiétés. Parmi les hypothèses envisagées, il y avait celle qu’Isidore aurait été pris pour rejoindre un contingent de jeunes, pour la construction du fameux mur de l’Atlantique, dont nous avions entendu parler. En fait nous voulions nous persuader qu’en France non occupée, nous étions en sécurité ! Il nous a fallu bien vite déchanter lorsque le lendemain à l’aube, le mercredi 26 août 1942, des gendarmes ont violemment frappé à notre porte.
Norbert avait dormi à la maison. Mon père, d’un geste, nous a désigné la porte donnant sur la cour. Précipitamment nous sommes sortis. Restés cachés derrière un muret durant un long moment et ne voyant pas les gendarmes partir, nous nous sommes enfuis par une porte latérale. Par chance l’immeuble se trouvait à l’angle d’une rue et avait deux issues. J’ignorais bien sûr que les gendarmes attendaient que mes parents et Erika se préparent pour les emmener.
Norbert a pris l’autocar pour retourner chez lui tandis que j’ai couru frapper à la porte d’un officier en retraite. Dans son uniforme de commandant il m’avait impressionné par son allure. Je le savais gaulliste et pensais naïvement pouvoir compter sur son aide. Mon père le considérait comme un ami et se rendait chez lui pour écouter Radio-Londres. J’ignore toutefois en quelle langue ils communiquaient, mon père ne parlant pas français.
Longuement j’ai sonné à sa porte. Contrairement à mon attente, elle est restée fermée. Pourtant j’ai entendu des pas derrière elle ! Savait-il pourquoi j’insistais tant ? Pour quelle raison refusait-il de venir à mon secours ? Je l’ignore ! Il ne prenait pourtant à ce moment aucun risque. Être gaulliste semble avoir été sa seule qualité ! Après la Libération, j’ai appris qu’il était devenu le responsable de la résistance locale ! Quelle ironie ! À mon égard, il avait manifestement manqué de courage et de solidarité.
Obligé de faire un grand détour, sa maison jouxtant la gendarmerie, je me rendis chez le docteur Ricalens, ne pouvant aller chez nos amis Brunel, Crayol ou Pauline au Padouvenc-Notre-Dame, nos bonnes relations avec eux étant trop connues. Lui seul pouvait se rendre auprès de mon père sans éveiller de soupçons. En possession d’une voiture, rare à l’époque, il aurait pu éventuellement me conduire à une cachette.
La domestique m’apprit que le médecin, malgré l’heure matinale, était déjà auprès d’une de ses malades. Désemparé, angoissé, ne sachant où aller, j’ai demandé à rester dans l’entrée qui faisait office de salle d’attente. Soudain, la sonnerie de la porte m’a fait tressaillir, au lieu de me cacher, instinctivement j’ouvris et me suis trouvé nez à nez avec deux gendarmes venant voir le docteur à mon sujet. Le Brigadier m’a interrogé avec agressivité :
« Tu t’appelles comment ?
– Paul !
– Paul comment ?
– Schaffer
– Ça fait un sacré bout de temps qu’on te court après, on t’emmène ! Tes parents sont arrêtés et déjà loin ! »
J’étais naturellement effrayé et ne comprenais pas ce qui nous arrivait. En fait c’était les rafles du mois d’août 1942, en zone libre ! Ainsi s’est achevée ma tentative d’évasion. Tenu comme un malfaiteur fermement par les poignets, rouge de honte, j’ai dû traverser le village ! Ceux qui ont assisté à cette scène, pouvaient-ils imaginer que mon arrestation était due au seul fait que j’étais juif ? L’acharnement de ces gendarmes pour rattraper le jeune fugitif que j’étais alors paraît aujourd’hui incompréhensible ! Un peu de bonté, un peu d’humanité de leur part, et mon destin aurait été tout autre… Ils m’ont fait rejoindre, en voiture encadrée par deux gendarmes, le fourgon qui était déjà à Saint-Julia distant de dix kilomètres, dans lequel se trouvaient d’autres familles juives des environs, avec entre autres nos amis Berger et leurs trois jeunes enfants, dont la petite Susie âgée de trois ans, si mignonne avec sa tête blonde toute frisée. Mes parents et Erika furent consternés de me voir. Ils avaient tellement espéré que j’aie réussi à m’enfuir !
Après avoir accompli leur triste mission, les gendarmes nous ont conduits au camp de Noé, près de Toulouse. Nous étions profondément abattus, et personne ne parlait. Le discours d’accueil, glacial et menaçant du garde mobile commandant du camp, nous prévenant qu’il serait tiré à vue sur toute personne tentant de s’enfuir, a fini par nous démoraliser. Les femmes furent séparées des hommes.
Assis sur le châlit auprès de mon père, je lui racontai les circonstances de mon arrestation et les raisons qui m’avaient fait rechercher de l’aide auprès du docteur Ricalens et la dureté des gendarmes qui ne m’avaient même pas autorisé à retourner à la maison pour prendre quelques vêtements. Lors de ma fuite, j’avais enfilé à la hâte un pantalon et une veste sur mon pyjama, sans avoir eu le temps de mettre des chaussettes ni de prendre mes téphillin (phylactères)(1) auxquels je tenais particulièrement. Depuis notre départ de Vienne, je faisais mes prières quotidiennes, respectant la promesse que j’avais faite lors de ma Bar Mitzvah.
Un homme âgé, témoin de mon récit, avec un doux sourire m’a offert les siens. J’ai réussi à les garder jusqu’au camp de Tarnowitz, et, durant les deux premiers mois, tôt le matin, je faisais discrètement mes prières, jusqu’au jour où, lors d’un contrôle, un kapo les a trouvés sous mon matelas et les a jetés avec rage et mépris contre le mur, tout en m’accablant d’injures.
Papa m’expliqua qu’Erika avait insisté auprès des gendarmes pour faire venir le docteur Ricalens, afin qu’il puisse déclarer notre père trop malade pour être arrêté. Elle s’est heurtée à un refus catégorique, mais a probablement éveillé leurs soupçons, d’autant qu’en touchant mon lit, ils l’ont encore trouvé tiède, concluant que je venais tout juste de m’échapper.
La première nuit à Noé, mon voisin de châlit s’est tailladé les veines des poignets. Le bruit des gouttes de sang tombant sur le sol en cadence régulière m’a réveillé. J’étais paralysé de frayeur. La gravité de notre situation m’est alors apparue dans toute sa dimension. Ce malheureux, sauvé in extremis, a été déporté avec nous.
Le lendemain furent annoncés les noms des personnes destinées au départ pour Drancy. Seuls Erika et moi étions sur la liste, mon père avait été finalement reconnu intransportable, et Maman autorisée à rester auprès de lui. Quel dilemme pour une mère de devoir choisir entre laisser partir ses enfants vers l’inconnu ou abandonner son mari souffrant !
En larmes, mon père a encouragé sa femme à nous accompagner. Cette séparation tragique restera un souvenir inoubliable. Le voir pleurer pour la première fois fut pour moi une indescriptible et durable affliction. Aujourd’hui, après tant d’années, je ressens encore son étreinte, cette étreinte qui fut la dernière. Avec une tendresse infinie, il m’a enveloppé dans son manteau, bien trop grand pour moi, et m’a dit en m’embrassant :
« Là où tu vas, Paulchen, tu en auras certainement plus besoin que moi ! »
Très vite, il s’est avéré utile. Lorsque nous sommes arrivés en Haute-Silésie, la neige commençait déjà à faire son apparition, et les matins le froid était rigoureux.
Le 1er septembre, toujours gardées par des gendarmes, 170 personnes sont parties à pied de Noé pour la gare de Portet-sur-Garonne. Cette marche de quelques kilomètres fut éprouvante, surtout pour les personnes âgées et les mères portant leur bébé dans leurs bras. Il est impensable d’imaginer que les lamentations de cette colonne humaine aient pu laisser indifférents les témoins de ces scènes.
Informé de la souffrance endurée par ces « proscrits », l’archevêque de Toulouse, Jules-Giraud Saliège, a rédigé au début de septembre 1942 une émouvante lettre pastorale, lue dans toutes les églises de son diocèse dont voici le contenu.
Mes très chers frères !
Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l’homme ; ils viennent de Dieu. On peut les violer. Il n’est au pouvoir d’aucun mortel de les supprimer.
Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d’une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d’asile dans nos églises n’existe-t-il plus?
Pourquoi sommes-nous des vaincus ?
Seigneur ayez pitié de nous.
Notre-Dame priez pour la France.
Dans notre diocèse, des scènes émouvantes1 ont eu lieu dans les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier.
France, patrie bien-aimée, France qui porte dans la conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse, je n’en doute pas, tu n’es pas responsable de ces erreurs2. Recevez, mes chers frères, l’assurance de mon affectueux dévouement.
Archevêque de Toulouse
Septembre 1942
« Traités comme un vil troupeau. »
« Embarqués pour une destination inconnue. »
Ces deux phrases, à elles seules ne laissent aucun doute. Certains Français avaient parfaitement connaissance de la périlleuse situation des Juifs en France !
Présageant l’importance et l’influence que pourrait avoir la lecture dans les églises de ce témoignage profondément humain, les autorités ont donné l’ordre de faire passer les Juifs plus discrètement la nuit, par les villages ! Cela ne diminuait en rien les souffrances des familles et surtout la culpabilité des responsables.
Les 8, 10, 24 août et 1er septembre 1942, 742 personnes ont été déportées du camp de Noé dont quarante-huit jeunes de moins de dix-huit ans. Quarante années plus tard, j’ai inauguré une stèle à la gare de Portet-sur-Garonne, à la mémoire de ces quarante-huit jeunes dont je suis le seul survivant. Il a fallu du temps !
Harassés après une nuit de train, nous sommes arrivés à Paris et avons été répartis dans des autobus, surveillés par des agents de la police parisienne, et conduits à Drancy, proche banlieue de la capitale. Durant le trajet, certains policiers nous ont perfidement suggéré de leur donner l’argent et autres objets de valeur que nous avions sur nous, affirmant :
« Là où vous allez, les Allemands vous prendront tout. »
Effectivement, arrivés à Drancy, tous les biens ont été confisqués par des fonctionnaires en échange d’un reçu… Il faudra attendre la commission MattEoli en 1997 pour tenter de régler le problème de la restitution des biens juifs spoliés.
La cité de la Muette à Drancy, appelée très vite « Drancy la peur », réquisitionnée par les Allemands en juin 1940, était un bâtiment à peine achevé en forme de « U », transformé sommairement en un camp de rassemblement et de transit, à caractère concentrationnaire. Nous n’y sommes restés que trois jours, mais c’était largement suffisant pour prendre conscience de l’ampleur du désastre. La rumeur faisait croire que nous allions être « dirigés » d’un jour à l’autre vers un camp de travail, dans un pays de l’est de l’Europe. Par dérision cette destination fut appelée Pitchipoï, ville imaginaire du folklore juif…
L’atmosphère à Drancy était irrespirable, l’hygiène était totalement absente, la nourriture répugnante. Les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards, les malades se trouvaient dans les mêmes chambrées, couchés ou assis sur la paille.
Dans les cages d’escalier, des hommes et des femmes s’accouplaient une dernière fois, sans pudeur, comme un défi lancé au destin. Très pudique, je me rappelle combien ces scènes m’avaient alors choqué… Aujourd’hui, je comprends et éprouve un sentiment de pitié pour ces actes d’amour, commis dans le désespoir et le pressentiment de la mort.
Erika avait du mal à avaler la soupe infecte, servie en guise de repas du soir. J’insistais auprès d’elle pour qu’elle se nourrisse afin d’avoir la force de résister aux durs moments qui nous attendaient… Maman fut surprise et émue par les conseils de sagesse que je donnais à ma sœur aînée, pensant probablement combien j’avais été choyé et protégé par elle. L’émigration m’avait fait passer de l’enfance à l’adolescence, la déportation m’a rendu prématurément adulte.
Drancy, antichambre de la mort, début de la descente aux enfers, avec ses murs noircis de messages déchirants de révolte, de résignation, d’amour et même parfois d’un surprenant courage, qui s’adressaient aux êtres aimés, abandonnés et restés sans nouvelles. Deux de ces inscriptions m’ont marqué et restent dans ma mémoire jusqu’à ce jour :
« On entre, on crie, c’est la vie. On crie, on sort, et c’est la mort. »
La seconde, comme une lueur d’espoir, m’a souvent redonné le courage de continuer à lutter, même dans des moments insupportables :
« Quand il n’y a plus rien à espérer, c’est là qu’il ne faut pas désespérer. »
L’espoir est l’ultime devoir lorsque aucune issue n’apparaît à l’horizon.
Le 4 septembre 1942, par le train no D901/23 du convoi no 28, à 8 heures 55, Maman, Erika et moi avons quitté Drancy par la gare du Bourget, pour une destination inconnue. Ce train emportait 999 personnes.
En 1945, seuls vingt-cinq hommes et deux femmes ont survécu.
C’est dans des wagons cadenassés, prévus pour « 8 chevaux ou 40 hommes », avec pour toute aération des petites ouvertures grillagées, que furent entassées environ soixante-dix personnes, femmes, enfants de tous âges, hommes, vieillards et invalides. Au sol se trouvait un peu de paille et dans un coin deux seaux, l’un contenant de l’eau potable, l’autre, devant lequel nous avions suspendu une couverture, prévu pour les besoins naturels. Il était devenu évident que notre destination ne pouvait pas être un camp de travail comme on essayait de nous le faire accroire !
Le voyage paraissait n’en plus finir, et l’angoisse grandissait au fur et à mesure. Dans ces sinistres wagons, l’odeur était irrespirable. Affamés, assoiffés, les gens pleuraient, gémissaient, certains frisaient l’hystérie.
Plus tard, j’ai appris qu’à l’arrivée on comptait parfois jusqu’à trente morts par wagon. Pour la majorité, ce fut le dernier voyage. Nous nous trouvions dans un état d’épuisement total physique et moral quand, après plusieurs jours de voyage, le train s’est arrêté en rase campagne près de Kosel, dans la région d’Auschwitz en Haute-Silésie. Les portes des wagons furent ouvertes avec fracas. L’aboiement des chiens se mêlait aux hurlements des SS ordonnant aux hommes valides de dix-huit à quarante ans de sauter sur le ballast, à plus d’un mètre cinquante du sol : « Schnell, schnell ! Raus ! » C’est dans ce vacarme et une panique infernale que les familles ont été séparées.
Bien que n’ayant pas encore dix-huit ans, sachant que je ne pouvais être d’aucun secours pour ma mère et ma sœur, je ne voulais pas rester avec les enfants et les personnes âgées et souhaitais me joindre aux hommes valides. J’ai dû m’arracher à l’étreinte de ma mère. Devant mon insistance, elle a finalement cédé. Me serrant contre elle, le visage baigné de larmes, elle mit autour de mon cou en un geste purement symbolique son carré de soie, que j’ai réussi à garder précieusement quelque temps. Notre séparation fut un véritable déchirement.
Tous les déportés n’ont pas eu le privilège de pouvoir embrasser leurs proches avant l’ultime séparation. J’entends encore les cris et les pleurs des familles désunies. Les vociférations des SS, les aboiements des chiens laissaient peu de temps à de longues effusions !
Lorsque le train est reparti et a emporté Maman et Erika, j’ignorais heureusement le sort qui les attendait. L’horrible vérité, je l’ai apprise un an plus tard. Après l’arrêt à Kosel, elles avaient été acheminées directement vers les chambres à gaz de Birkenau.
Notre groupe, composé d’environ 250 hommes, fut conduit au camp de Tarnowitz, un des quarante-six camps satellites faisant partie de l’organisation Schmelt. Nous y avons trouvé des déportés provenant de presque tous les pays d’Europe envahis par les nazis. À l’une des extrémités, il y avait une baraque réservée à une trentaine de femmes, chargées de la maintenance du camp et de la cuisine. Leur présence m’a fait espérer que Maman et Erika se trouvaient non loin de là dans les mêmes conditions, ce qui me paraissait logique. J’ignorais alors que rien ici ne fonctionnait suivant une logique commune.
À travers le grillage qui nous séparait, une jeune fille, chétive et pâle, m’a souri. Nous avons parlé de nos familles, partagé l’inquiétude de notre devenir. Son doux regard posé sur moi me fut d’un grand réconfort, et sa sollicitude dans ce milieu hostile m’a rappelé la fréquente bénédiction de ma grand-mère :
« Que la bienveillance de ton prochain t’entoure et que Dieu te protège ! »
J’ai réalisé à ce moment-là le sens profond de ses invocations fréquentes qui m’ont suivi au cours de ma vie.
Rachel travaillait à la cuisine. Avant de nous séparer, elle m’a promis que tous les soirs elle déposerait, pour moi devant le grillage, un bol de soupe. Accablé par les dures journées qui débutaient à l’aube et se terminaient le soir venu, quel réconfort de trouver la soupe providentielle et surtout plus consistante que celle normalement distribuée ! Pas une seule fois ma petite amie Rachel n’a manqué à sa promesse ! Ce supplément de nourriture m’a sans aucun doute aidé à mieux supporter ce premier hiver et les six mois à Tarnowitz. Je l’entrevoyais de temps en temps seulement et recevais son sourire comme un encouragement précieux. J’ai trouvé en elle, d’une façon inattendue dans ce lieu maudit, un peu de solidarité et de bonté !
Ici notre travail consistait à déplacer sur nos épaules des poteaux télégraphiques, des traverses et des rails pour réparer des voies de chemin de fer affaissées. Nous étions surveillés par un kapo et un contremaître. Ce dernier était un véritable tortionnaire faisant pleuvoir des sévères coups de canne sur celui qui s’avisait de lever la tête de son travail, ne fût-ce qu’un court instant.
Torse nu, par un grand froid, en dépit d’un travail ininterrompu, nous ne parvenions pas à nous réchauffer. À ce rythme infernal, beaucoup s’effondraient en peu de temps. Rapidement je me suis rendu compte que l’on s’acharnait davantage sur ceux qui semblaient être des « intellectuels ». Bizarrement les porteurs de lunettes étaient classés parmi ceux-là. Aussitôt je me suis défait des miennes. Connaissant les nazis, de par mon passé viennois, j’ai prétendu être menuisier comme mon père. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la lutte des classes ne semblait pas s’être arrêtée aux portes de l’enfer !
Je m’étais fait un ami de mon âge, Dev. Il était hollandais, très isolé car ne parlant que sa langue maternelle et un peu d’allemand. Chaque soir je lui donnais un peu de ma soupe supplémentaire que je recevais de la petite Rachel et qu’il réchauffait et surveillait sur l’unique poêle, très convoité, de la baraque. Il ne pouvait pas la quitter des yeux, elle était si précieuse, et les chapardages très fréquents ! Nos camarades se pressaient autour du poêle dès le retour du travail pour faire sécher leurs vêtements mouillés par la pluie ou par la neige fondue. Certains y faisaient griller de fines tranches de pommes de terre, convaincus que grillées elles avaient davantage de consistance et calmaient mieux leur faim. Des illusions de ce genre et bien d’autres faisaient partie de notre existence.
De temps en temps il y avait des tentatives d’évasion. Elles étaient rares, vouées à l’échec, et les sanctions infligées sévères. Un de nos gardiens, particulièrement machiavélique, ordonnait par jeu à un déporté, sous un prétexte quelconque, de s’éloigner du chantier. Aussitôt il était arrêté par les hurlements et des coups de sifflet, et accusé d’avoir tenté de s’évader. Un de mes amis français fut ainsi condamné à vingt-cinq coups de bâton. Au premier, sous la douleur, il s’est écrié :
« Merde ! » qui fut interprété par son bourreau comme Mörder (assassin). De rage il a été frappé de plus belle et en piteux état transféré dans un autre camp.
Aux personnes malades il était conseillé de se faire affecter au « sanatorium » où de meilleurs soins leur seraient dispensés ! La véritable destination, nous l’avons compris plus tard, tout comme les transferts dans un autre camp, était la chambre à gaz.
Un jour j’ai retrouvé David Berger avec qui nous avions été arrêtés à Saint-Julia. Cet homme que j’avais connu alors, grand, fort et jovial, était devenu méconnaissable, il avait à peine trente-cinq ans. À bout de forces, décharné, il m’a imploré :
« Paul, tu es jeune, moi je suis épuisé. Si tu sors d’ici, promets-moi de t’occuper de mes enfants ! »
Je ne l’ai plus revu !
Après six mois, brusquement nous avons été transférés au camp de Schoppinitz, non loin de là, plus sinistre encore que Tarnowitz. Je fus séparé de Rachel sans pouvoir lui faire mes adieux et lui dire, comme j’aurais tant aimé le faire, combien sa fidèle amitié m’avait été précieuse durant tous ces mois.
Schoppinitz se trouvait dans un angle, délimité par deux voies de chemin de fer qui semblaient se rejoindre à l’horizon. Le ciel y était bas et toujours sombre.
De nombreux trains passaient devant le camp. Certains transportaient des Ukrainiens vers l’Allemagne pour y travailler. Les portes coulissantes de leurs wagons étaient souvent ouvertes, et lorsque nous nous trouvions à proximité nous leur quémandions de quoi manger. Émus par notre aspect, ils nous lançaient des morceaux de pain, parfois moisis. Nous les avalions néanmoins avec avidité. Ils devaient avoir quitté leurs foyers depuis fort longtemps…
D’autres convois, plus sinistres, transportaient des Juifs dans des wagons semblables à ceux qui nous avaient amenés ici, les emportant vers la mort. Impuissants, nous entendions leurs pleurs et leurs gémissements. Nous pouvions parfois entrevoir un visage amaigri à travers les petites lucarnes grillagées.
Inoubliable est le jour où un train de chars se dirigeant vers le front russe s’arrêta à notre hauteur. De l’une des plates-formes, un SS pour « se divertir » a balayé le camp d’une rafale de mitraillette. Plusieurs camarades ont été tués sous mes yeux. L’un d’eux faisait office d’infirmier et portait, visiblement, un brassard marqué d’une croix rouge. Ce fut une scène hallucinante. Depuis ce carnage, chaque fois qu’un train militaire s’arrêtait à proximité, nous étions pris de panique. Nous vivions ainsi quotidiennement dans un univers infernal où nos repères avaient disparu.
Nos journées se passaient à décharger des wagons de charbon, de sable ou des sacs de ciment de cinquante kilogrammes. Leur poids dépassant le nôtre, nous devions les porter sur notre nuque. Les coups s’abattaient sur celui qui perdait l’équilibre en descendant des wagons le long des planches oscillantes, instables.
Souvent le contenu des sacs en se déchirant se répandait sur le sol et imprégnait nos vêtements. Ces sacs faits de plusieurs couches de papier épais, nous les mettions, bien que ce fût interdit, sous nos vestes afin de nous protéger un peu du froid et de la pluie. En rentrant au camp nous étions gris du ciment qui collait sur notre corps, ce qui nous donnait l’air de clowns tragiques.
Afin d’améliorer ma ration quotidienne, je suis devenu repriseur de chaussettes. Seuls les kapos, cuisiniers et autres privilégiés, appelés Prominenten (dignitaires), en possédaient. Nous, depuis fort longtemps, devions nous contenter de « chaussettes russes », faites de morceaux de chiffons avec lesquels nous enveloppions tant bien que mal nos pieds nus. C’était une maigre protection contre le froid, et le frottement de nos galoches provoquait des blessures qui se transformaient en plaies purulentes.
En compensation de mon travail, je recevais quelques pommes de terre, un peu de soupe, parfois un morceau de pain hautement apprécié. Ne pouvant résister au regard avide de Dev, je lui en offrais une petite part. Ces suppléments nous permettaient de conserver un morceau de pain pour ne pas rester sans nourriture toute la journée du lendemain. Dev et moi le cachions sous nos têtes pour le protéger du vol durant la nuit. Le matin nous n’avions qu’un prétendu café-ersatz, qui avait pour seul avantage d’être chaud, et à midi une soupe très fluide.
Un matin au réveil, Dev, contrarié, découvre que son pain lui a été dérobé. Aussitôt je regardai sous ce qui me servait d’oreiller pour constater avec horreur que le mien avait également disparu. Un de mes voisins, qui se trouvait au niveau inférieur de mon châlit, dans un état squelettique, plus âgé (pour l’adolescent que j’étais un homme de trente ans me paraissait vieux), m’a offert trois minuscules pommes de terre et une fine tranche de pain. À peine consistante ! Quel mot trouver pour qualifier ce geste, cette abnégation, venant d’un être souffrant de tous les malheurs dans cet endroit où toute sensibilité semblait inexistante… ?
Dans notre baraque les vols se multipliaient. Dev, soupçonné, fut transféré dans une autre, et les vols cessèrent. Je ne voulais et ne pouvais croire en sa culpabilité. Mais, quelques jours plus tard, au réveil, il est venu vers moi en courant pour m’avouer que torturé par la faim il avait été pris en flagrant délit et m’a supplié de lui garder mon amitié, m’assurant qu’il supporterait alors plus facilement la bastonnade qui lui serait infligée lors de l’appel et sa mise en quarantaine que nous réservions aux voleurs. Ainsi celui que je croyais mon ami avait aussi volé mon pain ! J’étais profondément heurté, choqué et attristé. C’était trop grave, je n’ai pu lui accorder mon pardon.
Aujourd’hui je regrette ma sévérité. Dev, comme tant d’autres, avait beaucoup de mal à maîtriser la faim lancinante et obsédante qui nous tenaillait tous. Nous pensions du matin au soir au moyen de trouver de la nourriture. La faim annihilait nos réactions, notre intelligence, notre bon sens. Seuls ceux qui ont souffert ou souffrent des affres de la faim peuvent comprendre que l’on puisse être poussé à agir d’une façon aussi condamnable : ôter un peu de vie à son camarade de misère, en lui volant un morceau de son pain.
Nos bourreaux, les vrais responsables, qui nous faisaient atteindre l’extrême limite du supportable, se réjouissaient de tels incidents et punissaient parfois aussi bien le coupable que sa victime. Tout était imprévisible. Un jour un kapo, dont le comportement habituel était pourtant assez convenable, a battu à coups de cravache avec une inexplicable colère un de mes camarades sur le lieu de travail. Sanglotant, celui-ci le maudit en yiddish : « Que les mains lui tombent ! » Quelques jours plus tard, hasard ou justice immanente, ce kapo a eu quatre doigts écrasés entre deux wagons qui se tamponnaient. Cette blessure lui a valu d’être éliminé lors de la sélection qui a suivi.
En novembre 1943, notre séjour à Schoppinitz prit fin. Nous ne connaissions pas la prochaine étape. Notre grande frayeur, due à la menace permanente d’être envoyés pour la moindre « désobéissance » ou manque de « discipline » à Auschwitz, tristement réputé, était obsessionnelle. En apprenant que nous allions à Birkenau, naïvement nous étions soulagés. Aussi, lorsque après un court trajet, le train s’immobilisa en gare d’Auschwitz, nous étions accablés. La crainte du pire était devenue réalité : Birkenau était synonyme d’Auschwitz.
Cet immense univers concentrationnaire était divisé en plusieurs camps :
- Auschwitz I = Stammlager (essentiellement pour les prisonniers politiques polonais) ;
- Auschwitz II = Birkenau (camp de travail et camp d’extermination, essentiellement pour les Juifs) ;
- Auschwitz III = Buna Monowitz (industrie chimique IG Farben).
Il s’étendait sur près de quarante kilomètres carrés, soit l’étendue de la ville de Metz. Mais ce genre de comparaison n’a guère de sens. Auschwitz est imbibé de larmes, de sang, de désespoir. Les cendres de centaines de milliers de morts recouvrent son sol. C’est le plus grand cimetière du monde. C’était le royaume de la mort et du mal absolu. Nos bourreaux mettaient ici en application la « solution finale », dont les modalités d’application ont été prises à Wannsee, près de Berlin, en janvier 1942. Elle signifiait l’extermination industrielle et totale de tous les Juifs se trouvant sous la domination des nazis, et il fallait l’organiser avec efficacité, dans un secret absolu.
Birkenau, aménagé en 1941, s’étendait sur 175 hectares, à trois kilomètres d’Auschwitz I et semblait, par son environnement, prédestiné à cette infernale entreprise. C’était le camp central de nombreux autres camps satellites qui se trouvaient en Silésie et fournissaient de la main-d’œuvre aux mines de charbon (Janina, Jaworzno, etc., aux usines de guerre de Gleiwitz, Siemens, Buna, IG Farben, etc.). En échange, Birkenau recevait les inaptes au travail et se chargeait de les faire disparaître à tout jamais. C’est ici que les nazis avaient construit les chambres à gaz et les fours crématoires qui fonctionnaient jour et nuit et répandaient une odeur pestilentielle, odeur qui a détruit en partie mon sens olfactif.
Sur un terrain marécageux, exposé au vent, écrasé sous un ciel bas et gris, entouré par une double rangée de fil de fer barbelé sous haute tension, tous les 200 mètres environ se dressait un mirador avec sur les plates-formes des soldats équipés de mitrailleuses. La nuit, des projecteurs balayaient le camp sans interruption. Au-delà on ne voyait que d’immenses étendues recouvertes en hiver d’un linceul de neige. L’hiver semblait ici interminable. Je n’ai pas souvenance de présence d’arbres.
Birkenau était divisé en plusieurs secteurs : le camp de travail, celui des femmes, la quarantaine, le camp des Tziganes, l’infirmerie centrale, etc. Ceux qui n’étaient pas gazés aussitôt arrivés passaient par la quarantaine. S’ils survivaient, ils allaient ultérieurement au camp de travail. En arrivant, intrigué, j’observais non loin de là des hommes en tenue de bagnards. Courbés et traînant le pas, ils transportaient péniblement des pavés qu’ils prenaient sur un tas pour en faire un autre, un peu plus loin. Ce travail, effectué au même rythme du matin au soir, était considéré comme un moyen de rééducation et d’adaptation à la vie de la quarantaine ! En fait, il était destiné à user l’énergie et le moral des déportés. Il était difficile de résister à ce régime longtemps.
Afin de contrôler, à l’arrivée, notre état physique, on nous obligeait à courir par rangées de cinq. Ceux qui semblaient trop faibles étaient immédiatement éliminés. Parqués ensuite dans une baraque, nous avons été accueillis avec un discours édifiant d’un kapo (Kamp Polizei) ponctuant ses propos de coups de cravache sur ses bottes impeccablement cirées :
« Votre vie jusqu’à présent a été “douce” en comparaison de celle qui vous attend ici ! »
Ce n’était pas une menace, c’était un avertissement ! Après ce préambule, de retour dans la cour, agressés par un froid glacial (nous étions en novembre), on nous a dépouillés de nos vêtements, rasés de la tête aux pieds, avec un rasoir dont le tranchant était depuis longtemps émoussé, puis tatoués comme du bétail d’un numéro sur notre avant-bras gauche(2). Le mien est : 160610. Déshumanisés, humiliés, réduits à un chiffre abstrait, nous avons perdu notre identité.
(Un jour, interpellé par un kapo « drôle de numéro », je me suis rendu compte de sa particularité. Dans 160610, chaque chiffre est répété deux fois, et les sommes 1 + 6 et 6 + 1 = 7. Le chiffre 7 est également contenu deux fois, chiffre hautement symbolique qui n’a évidemment de sens que pour ceux qui sont attachés aux mystères des lettres et des chiffres. Parmi les multiples sens donnés, nous trouvons dans la Kabbale : Vie, Paix, Science, Richesse, Grâce, Semence, Domination. Dans d’autres philosophies sont retenues les sept vertus : Loyauté, Courage, Patience, Tolérance, Prudence, Amour, Silence, etc.)
Puis ce fut le passage sous une douche froide, sans pouvoir nous essuyer. Nous sommes restés à nouveau dans la cour, nus, agglutinés les uns aux autres pour tenter de nous réchauffer… Enfin, on nous distribua les hardes qui allaient devenir nos vêtements : des pyjamas usagés à larges rayures, une chemise sans col et un culot, le tout taillé dans un tissu en fibranne dégageant une forte odeur de désinfectant, et pour finir une paire de galoches à semelles de bois. Rien ne correspondant à notre taille, il fallut faire rapidement des échanges entre nous. En regardant mes camarades je n'ai eu aucun mal à imaginer mon allure.
Nous voilà intégrés dans cet ensemble concentrationnaire et passons notre première nuit, épuisés, dans une baraque et devant nous l’inéluctabilité de notre sort. Sur des châlits à trois niveaux, six par étage, chacun disposant d’environ cinquante centimètres, avec pour couche une maigre paillasse puante et pour nous couvrir une mince couverture en coton. Cette nuit comme toutes celles qui suivirent furent de véritables cauchemars.
Les anciens détenus, décharnés, aux yeux hagards, exorbités, appelés «musulmans», selon l’expression du camp, terme nullement péjoratif, mais parce que leur fin semblait proche. Indifférents à tout, y compris à leurs paroles, essayant de ménager leurs maigres forces, en restant assis immobiles et en tirant la mince couverture sur la tête, fléchis en avant, ressemblant à des musulmans en prières et semblaient ne plus concernés par ce monde irréel.
Je lui demandais d’où venait cette odeur lancinante et les flammes qui sortaient d’une cheminée d’un bâtiment proche. D’une voix à peine audible, il me demanda:
« Si tes parents ont été déportés avec toi, ils sont entrés par la porte et sont sortis par cette cheminée ! »
J’ai cru qu’il était fou ! Cela me semblait invraisemblable ! Je me refusais de croire à cette horreur…C’était au-delà de l’imaginable ! Mais le choc de l’invraisemblable est vite devenu une implacable certitude. Combien de déportés ont été, dès leur arrivée, poussés sous des soi-disant douches, systématiquement gazés, brûlés et partis en fumée ?
Une intolérable tâche, étroitement surveillée par les SS, était confiée à un groupe de détenus. Ils étaient contraints de sortir des chambres à gaz les cadavres écrasés, amoncelés et de les transporter dans les fours crématoires pour y être brûlés et en dépouillant les cadavres des dents en or ou bagues. Ces malheureux, chargés de cette horrible besogne formaient le «Sonderkommando» (Commando spécial) et savaient qu’après quelques mois de ce travail inhumain, ils seront à leur tour gazés.
Je me trouvais à présent dans un «camp d’extermination», et non pas dans un camp de concentration, énorme différence dans l’horreur ! L’illustration de cette différence est confirmée par le fait qu'il y eu environ quarante pourcent de survivants des camps de concentration, alors que trois pourcent (2551) seulement des 76000 juifs déportés de France sont revenus des camps d’extermination.
Dans un discours Heinrich Himmler en octobre 1943 déclara :
« Si l’on conservait une population de détenus, c’était essentiellement pour l’utiliser comme main d’oeuvre. Le travail était un autre moyen pour exterminer les détenus! »
« Que les autres peuples vivent dans le bien-être ou qu’ils meurent de faim, cela ne m’intéresse que dans la mesure où nous pouvons les utiliser comme esclaves… »
Dans l’ensemble des entreprises situées dans les limites du Reich et dans les territoires occupés, travaillaient 500 à 600.000 détenus.
Depuis combien de temps des femmes, des hommes et enfants innocents avaient-ils été réduits en cendres? Combien de personnes ont été éliminées au cours des sélections fréquentes, parce que ne pouvant plus être exploitées comme main d’oeuvre utile à la machine de guerre nazie. Combien de vies inaccomplies, fauchées ? Quel outrage pour la valeur suprême, qu'est LA VIE ! Toutes ces pensées se bousculaient dans mon esprit.
Ce fut la journée la plus dramatique de ma vie concentrationnaire ! Comment trouver encore de forces pour lutter et tenter de survivre ? Avais-je seulement une chance d’échapper aux douches fatales ?
Après une période d’abattement, l’instinct de survie à pris le dessus et comme un défi j’ai fait mienne l’inscription que j’ai lu gravée sur le mur de Drancy :
«Quand il n’y a plus rien à espérer, c’est là qu’il ne faut pas désespérer.»
L’espoir et poursuivre le combat contre notre impuissance étaient les seules armes et le seul acte incontestable de résistance dont nous pouvions encore disposer.
Durant cette période de mise à l’écart du monde, j’ai eu le sentiment de subir une sorte d’initiation : Passant par l’épreuve de l’eau, du feu et du froid, abandonnant ma vie profane pour une hypothétique renaissance ultérieure. Mon âme en sortirait alors enrichie d’une expérience dramatique mais exceptionnelle.
“Souviens-toi que les hommes, bien qu’ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover, pour s’ouvrir à la naissance et à la renaissance.”
Le fascisme, avec son déluge de propagande, l’enseignement du mépris et de la haine, l’éducation raciste? a pourri, annihilé le sens moral et la conscience humaine de toute une génération d’Allemands, laissant aux générations à venir un très lourd héritage. Au lieu de la sarcastique inscription, peinte au-dessus du portail du camp:
« Arbeit macht frei », (Le travail rend libre)
Véritable insulte à la décence, aurait du figurer comme dans l’Enfer de Dante :
« Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ! »
Apprenant dès le lendemain de mon arrivé que des métallurgistes étaient recherchés,je me suis présenter comme tel, incité par mes études à l'école technique de Bruxelles. Bonzius, officier ingénieur, recrutant pour le compte des usines Siemens-Schuckert, groupe industriel, exploitant, comme beaucoup d'autres, la main d'oeuvre concentrationnaire, était chargé de faire passer à une centaine de déportés un examen, afin de déterminer leurs compétences. C’était une lueur d’espoir qui s’offrait à moi, peut être pourrais-je quitter cette quarantaine, véritable mouroir. Avec une centaine d’autres, je me suis mis dans le rang et présenté comme tourneur. Mes réponses approximatives et mon jeune âge ne pouvaient laisser aucun doute de mon incompétence. Après l’examen Bonzius me dit avec ironie :
- «Vous devez être un bon tourneur!» ( En allemand Dreher, a un double sens et signifie aussi « débrouillard ») Faisant mine de ne pas comprendre son allusion, je répondis : « Non, je ne suis pas un très bon tourneur! »
A ma grande surprise et soulagement j’ai été accepté avec cinquante autres «spécialistes ». Mon destin venait de changer. J’appartenais désormais au commando «Siemens-Schuckert».
Aussitôt nous avons été transférés au camp de travail et hébergés dans le Block 11 entouré d’un mur. Isolé ici afin de ne pas nous éparpiller parmi les milliers de déportés se trouvant dans le camp. Ce bloc abritait le «Strafkommando», (commando punitif), destiné à ceux qui soi-disant avaient tenté de s’évader ou avaient commis d’autres infractions. Un grand nombre était de repris de justice, reconnaissables à la couleur verte de leur triangle.
Chaque catégorie de déportés se distinguait par la couleur de leur triangle, imprimé devant le numéro et cousu sur la veste. Les politiques par le rouge, les asociaux par le noir, les homosexuels par le rose, les tziganes par le marron, les témoins de Jéhovah par le violet, les juifs par le jaune, les juifs politique rouge et jaune, au total il y avait onze couleurs distinctives.
Les « droits communs » ainsi que les « politiques » bénéficiaient de privilèges : Ils ne subissaient pas les sélections, n’étaient pas gazés, et assumaient pour la plupart les fonctions de chefs de block, Kapos ou avaient d’autres privilèges les mettant à l’abri des mauvais traitements. Ainsi les chefs de block disposaient d’une chambrée à eux seuls.
A chaque extrémité de la baraque, il y avait un poêle d’où sortait un tuyau longeant la baraque et recouvert de briques servant de banc. En hiver il s’en dégageait un peu de chaleur. Pour s’y asseoir et trouver une place, donnait lieu à d’invraisemblables bousculades. Les autres se tenaient recroquevillés dans leurs châlits.
Dans ce sombre univers, aucune fenêtre pour laisser apercevoir un peu de ciel ou la lumière du jour. Une petite lucarne aurait pu entrouvrir la porte des rêves…
Mais seuls les hommes rêvent et nous n’appartenions plus au monde des humains.
A la demande de Bonzius, nous bénéficions d'une gamelle de soupe supplémentaire afin de nous «remplumer» pour le travail que nous avions à accomplir. Bednarek, notre chef de block, (prisonnier de droit commun), véritable tyran, faisait payer cher le privilège accordé aux juifs, à qui il portait une incompréhensible haine. Sous prétexte de nous tenir en forme, il nous faisait faire de la gymnastique…
C’était généralement après la journée de travail. Alors que fourbus nous essayions de prendre un peu de repos, il nous réveillait avec brutalité au milieu de la nuit pour nous chasser dans la cour et nous faire courir, titubants sous les coups redoublés des Kapos.
Le 1er janvier 1944 eu lieu la plus importante sélection que j’ai connue à Birkenau.
Tous les détenus furent consignés pour défiler nus devant les démoniaques Dr Mengele et le SS Fischer.Souriants, désinvoltes, tout en conversant entre eux et fumant une cigarette, ils désignaient d’un geste indifférent, ceux qui bénéficiaient d’un sursis et devaient continuer à peiner et ceux qui attendraient dévêtus dans une autre baraque, l’aurore d’une nuit interminable, pour être gazés.
Je me dois de relater ici un évènement exceptionnel qui s’est produit ce jour-là dans ce monde dantesque. Trois de mes camarades se trouvaient parmi les sélectionnés. Je me souviens plus particulièrement de B. K. Les condamnés avaient été rassemblés après cette nuit de cauchemar, tôt au matin pour être amenés vers la chambre à gaz. Ces trois déportés ont été extraits du groupe au dernier moment parce que faisant partie de notre commando « Siemens Schuckert ». Ils sont revenus d’un autre monde au bloc 11 dans un état indescriptible. B. K. a survécu à la guerre. Traumatisé plus que tout autre, il parlait peu de sa déportation. Mort aujourd’hui, il a emporté avec lui ce souvenir tragique, enfoui durant sa vie au tréfonds de lui-même. Ce vécu raconté par la victime aurait très probablement rejoint la liste des faits IMPENSABLES, voire INCROYABLES.
En voyant le sourire de nos bourreaux, je ne pouvais m’empêcher de penser à l’extrait d’un poème de Henrich Heine, Atta Troll, appris il y a longtemps à Vienne.
"Weit impertinenter als durch Worte offenbart sich durch das Lächeln eines Menschen seiner Seele tiefster Frechheit." "Bien plus que par la parole, le sourire reflète la noirceur de l’âme »
De retour dans notre bloc après cette dure épreuve, Bednarek qui n’avait sans doute pas assouvit sa haine coutumière, il tendit un violon à Peter Dymhoff, musicien réputé, lui ordonnant de jouer ! Peter avec courage refusa obstinément. Furieux, Bednarek le roua de coups jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Impuissants, nous avons assisté à ce meurtre commis sous nos yeux.
“Pire que le bourreau est son valet.”
Plus que dans tous les autres camps, ici je sentais la mort rôder autour de moi. Je vivais en permanence dans son ombre et devais m’en accommoder. Elle a fini par ne plus me faire peur !
Plus que dans tous les autres camps, ici je sentais la mort rôder autour de moi. Je vivais en permanence dans son ombre et devais m’en accommoder. Elle a fini par ne plus me faire peur !
Dès quatre heures du matin, le jour pointait à peine, les «Stubendienst(3)» (adjoints des Kapos) jurant et hurlant nous réveillaient en tapant avec leurs bâtons sur les montants des châlits, frappant au hasard ceux qui n’étaient pas assez rapides pour se lever. Comme un troupeau affolé, nous courions aux latrines collectives, rudimentaires, dégradantes, assis les uns à coté des autres. Il y régnait une odeur nauséabonde. Un «Scheissmeister», (maître de chiotte), était chargé de réduire la durée de notre arrêt, considéré comme temps de repos. Puis dans la bousculade nous nous rendions aux lavabos pour procéder à une rapide et précaire toilette.
Et venait la torture de l’appel interminable du matin.
Nous étions rassemblés en colonne devant chaque baraque, harassés, chancelants, au passage des SS le chef du bloc ordonnait : «Mützen ab!» (Ôtez vos calots !) et si la cadence n’était pas rigoureusement précise, il hurlait à nouveau: «Mützen auf!» (Couvrez vous !) Cet exercice, comme nous n’étions pas assez rapide à leur gré, pouvait durer des heures !
Puis la tête découverte au passage des SS, le chef du Block annonçait les présents, les malades et les morts. Comme au fur et à mesure que le temps passait, les plus faibles s’affaissaient d’épuisement et mourraient. On recommençait alors jusqu’à ce que le compte soit rigoureusement exact. Peu importait à nos bourreaux la neige, le vent, la pluie. Peu leur importaient nos vêtements encore mouillés de la veille et qui ne nous protégeaient pas de la morsure du froid. Peu leur importaient notre longue station debout, chaussés de galoches jamais sèches, inlassablement ils s’acharnaient, comptant et recomptant vivants et morts.
Puis groupés par commando nous sortions au pas, accompagnés de la musique d’un orchestre, comble de dérision, formé d’une soixantaine de déportés, se tenant près du porche..
Le groupe « Siemens » avait la chance exceptionnelle d’être transporté par camion à son chantier de Bobrek, petit bourg situé à huit kilomètres de là, afin de transformer une ancienne briqueterie en usine de métallurgie et y aménager le futur camp de Bobrek.
De retour, il nous fallait entonner des chants de marche en allemand. Ceux qui ne parlaient pas la langue de Goethe devaient faire semblant de prononcer les paroles, afin d’éviter des coups !
Immuablement l’appel du soir reprenait, identique à celui du matin…
Enfin venait le moment tant attendu de la distribution de la soupe quotidienne, faite de pommes de terre, de rutabagas, de choux et de betteraves. Nous recevions un pain, mélange de farine et d’avoine, à partager équitablement en cinq parts égales. Ce n’était pas une mince affaire ! Nous procédions à la pesée avec une balance rudimentaire, confectionnée avec des morceaux de bois et de ficelle !
Je nous revois encore immobiles, affamés, le regard fixé sur ce partage rituel. Chacun avait la certitude que son morceau était un peu plus petit que celui du voisin, ce qui provoquait invariablement des disputes…
De temps en temps nous recevions un minuscule carrée de margarine et deux fois par semaine une mince tranche de saucisson. La soupe représentait l’essentiel de notre alimentation. A chaque distribution, pour une louche de soupe supplémentaire, des volontaires transportaient à bout de bras un énorme tonneau contenant plusieurs dizaines de litres. Nous nous précipitions pour faire la queue et tendre notre bol pour recevoir notre ration.
Se croyant plus futés, certains attendaient que les premiers soit servis, la soupe devenant au fur et à mesure plus épaisse. Mais il ne fallait pas rater le moment opportun et viser juste. Le fond du tonneau, la meilleure partie, revenait d’office aux Kapos et aux Stubendienst. Tant pis pour ceux qui n’étaient pas servis.
Cette nourriture tant attendue était vite engloutie ! Ceux qui avaient le sens de « l’organisation (4) » possédaient une cuillère. Ils pouvaient savourer leur soupe plus lentement et faire durer le plaisir. Quel luxe !
Notre maigre pitance terminée, venait la corvée de « Laüsekontrolle » ! Recherche des poux ! Nous en étions infestés et devions les écraser entre nos pouces. Il fallait surtout prendre soin de n’en laisser échapper aucun. Celui qui avait manqué de vigilance, était aussitôt conduit sous une douche d’eau glacée!
L’hiver 1944 m’a semblé être le plus dévastateur. D’innombrables personnes sont mortes, victimes d’une épidémie de typhus. Puis, vint un autre fléau : La gale que je n’ai pu malheureusement éviter : des démangeaisons étaient à ce point insupportables que je ne pouvais m’empêcher de me gratter jusqu’au sang ! Pour m’en guérir, j’ai du échangé ma ration de pain contre un médicament. Il fallait à tout prix éviter l’infirmerie, l’issue était fatale. Régulièrement un certain nombre de ces malades finissaient par être gazés.
La construction de l’usine Siemens, à Bobrek.
Pendant toute la durée de l’hiver une crise aiguë d’arthrite m’obligea à prendre appui sur des camarades pour sortir au travail, prenant garde de ne pas me faire remarquer. Il me fallait ensuite quelques heures avant de pouvoir plier les genoux et fermer les poings. Une autre épreuve m’attendait : de fréquentes dysenteries, affreusement pénibles dans nos conditions d’hygiène et de promiscuité. J’ai réussi à m’en débarrasser grâce à des morceaux de pomme de terre carbonisés.
Par chance dès que je le pouvais, je dormais. C’était un besoin irrésistible ! Je m’assoupissais même en marchant. Très longtemps j’ai eu l’impression d’agir comme un somnambule ! Je dormais dès que je le pouvais, dans n’importe quelle circonstance. Pour gagner quelques heures d’un précieux sommeil, je prenais un énorme risque. Durant plusieurs jours, après l’appel du matin, je retournais en catimini au fond de la baraque réservée aux Allemands, moins surveillée, et m’allongeais au troisième et dernier niveau de leurs châlits, pour y dormir jusqu’au retour de mes compagnons. Ce manège a duré jusqu’au jour où j’ai eu la faiblesse de dévoiler mon secret à un de mes camarades. Trouvant l’idée astucieuse, il m’a imité, se joignant à moi, et ce fut le désastre. Il ronflait tellement qu’il attira l’attention de Bednarek, chef du bloc ! Celui-ci avec un plaisir non dissimulé nous assena à tour de rôle vingt-cinq coups de canne sur le postérieur que nous devions compter un à un, suivis d’une heure de génuflexion, bras tendus, dans le froid et la neige de la cour. Ce genre de punition était monnaie courante.
De nombreux déportés s’affaissaient durant ces « exercices » et étaient achevés à coups de schlague par nos tortionnaires qui s’acharnaient toujours avec un plaisir sadique sur leurs victimes à terre. Longtemps le bas de mon dos est resté douloureux et m’obligea à dormir sur le ventre. Ainsi s’est terminé le bienfait de ces quelques heures de sommeil volées.
Les convois de Juifs hongrois commencèrent à arriver. À raison de 10 000 par jour, souvent plus. Seul un petit nombre échappait à la mort dès leur arrivée. Les fours crématoires avaient beau fonctionner sans relâche, jour et nuit, il était impossible de les réduire tous en cendres…
Il me restera toujours en mémoire le jour où, sortis trop tôt pour aller travailler, nous avons vu défiler devant nous un de ces convois. On obligea notre commando à se coucher dans le fossé avec l’interdiction absolue de leur adresser la parole. Des familles entières en longues colonnes passaient sous nos yeux. Exténuées, assoiffées, chargées de bagages, croyant aussi naïvement que nous l’avions cru, se rendre dans un camp de travail. À leur tête il y avait un groupe de hassidim, avec leurs longs manteaux et chapeaux noirs, entourant leur rabbin. L’un d’eux pieusement portait dans ses bras, serré sur son cœur comme un enfant fragile, une Torah. Confiants, presque sereins, murmurant des prières, ils s’acheminaient vers les chambres à gaz, vers la mort. Heureusement ils n’ont pu voir nos regards remplis d’effroi et de désespoir.
En mai 1944, après sept mois passés à Birkenau, j’ai quitté cet enfer… pour aller enfin au camp de Bobrek, l’usine que nous y avions construite étant terminée.
Du premier groupe d’une cinquantaine de spécialistes, sélectionné par Bonzius dans la quarantaine, nous n’étions plus que vingt ! Enfin nous échappions à l’odieuse emprise de Bednarek et aux interminables appels du matin et du soir. Soulagés de ne plus subir les fréquentes sélections, de nous trouver loin des chambres à gaz et des fours crématoires et de ne plus respirer l’entêtante odeur qu’ils dégageaient, mais aussi de nous trouver éloignés de l’orchestre au son duquel nous partions et revenions du travail. Sont venus se joindre à nous environ 250 hommes et 35 femmes. Celles-ci se trouvaient dans un bâtiment séparé de celui des hommes par un grillage. Après avoir travaillé durant vingt mois à l’extérieur, je me trouvais pour la première fois à l’abri des intempéries et des violences permanentes.
La nourriture était légèrement améliorée, et le plus apprécié et inattendu des changements fut un dimanche de repos sur deux. Les gardiens étaient moins agressifs, le commandant du camp, le SS Anton Lukaschek semblait avoir déversé sa hargne sur des précédents détenus. Ses préoccupations majeures étaient de ne pas être envoyé au front russe et de trouver assez de boissons alcoolisées pour se saouler. La présence quotidienne d’employés civils de l’entreprise Siemens-Schuckert et leurs besoins impératifs d’une production régulière ont contribué à nous rendre la vie moins dure.
Comme ancien, j’ai eu le privilège de pouvoir choisir la taille de la machine sur laquelle je devais travailler. J’ai choisi la plus petite, croyant pouvoir la maîtriser plus facilement. Cette appréciation était fausse, la dimension n’avait aucun rapport avec la difficulté des produits à réaliser, bien au contraire. Lors de la réalisation de ma première pièce, je me suis trompé de dix millimètres. Cette énorme erreur m’a valu un sévère avertissement du contrôleur allemand : « Une deuxième faute, et tu te retrouveras à Auschwitz ! » Sa menace fut efficace, je ne me suis jamais plus trompé !
À Bobrek, l’atelier des spécialistes «sélectionnés» par Bonzius.
Je suis de profil, second à partir de la gauche.
L’atelier des spécialistes de l’usine Siemens à Bobrek.
La salle des tours de l'Usine Siemens à Bobrek.
Usine Siemens à Bobrek. Établis des ajusteurs.
Zev est le deuxième au premier rang, près du mur.
Usine Siemens à Bobrek. Section des machines.
Usine Siemens à Bobrek. Autre vue de l’atelier des ajusteurs.
Des relations plus confiantes, plus solidaires s’étaient établies entre nous. La présence des femmes a grandement contribué à changer l’atmosphère et nous a réconfortés. Elles avaient toutes un comportement admirable et une grande dignité. Pourtant, leur vie dans cet univers était infiniment plus éprouvante que pour les hommes.
Mon amie Thérèse Glowinsky, maintenant notre doyenne, lorsqu’elle fut arrêtée a laissé ses trois jeunes enfants et son mari en France. Combien était grande l’inquiétude de ces femmes et de ces hommes qui ont dû laisser ainsi leur famille à l’abandon. Ils vivaient dans la peur permanente qu’à leur tour ces enfants ou ce mari soient aussi arrêtés et déportés. Thérèse, malgré son immense chagrin et son inquiétude, inlassablement encourageait ses compagnes à persévérer dans la lutte pour la survie.
En avril et mai 1944 avec les convois nos 71 et 73 la famille Jacob fut déportée. Madame Jacob et ses deux filles, Milou et Simone, furent déportées au camp de Birkenau, puis Monsieur Jacob et son fils ont été envoyés dans le camp peu connu de Kaunas (Kovno), en Lituanie.
Stanisla Starostka, redoutable responsable du camp des femmes, condamnée à la pendaison pour ses crimes après la Libération, se tenait près du portail. Remarquant Simone, qui avait alors seize ans, elle lui dit : « Tu es trop jeune et trop belle pour mourir, je vais t’envoyer quelque part où tu auras plus de chance de t’en tirer ! » Avec bravoure, Simone, sans prendre garde au risque qu’elle encourait, répondit : « Mais ma mère et ma sœur doivent rester avec moi ! »
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la fameuse Stanisla Starostka y consentit, bien que visiblement Madame Jacob, à la suite d’une opération subie peu avant sa déportation, était très amaigrie et d’une grande faiblesse. Ainsi, le courage et la beauté de Simone ont permis à sa mère et à Milou d’être affectées (avec trois autres déportées) au commando Siemens-Schuckert, à Bobrek. Une sœur aînée de Simone, Denise, a été déportée comme résistante, elle est heureusement revenue. Madame Jacob est décédée après l’évacuation d’Auschwitz. Milou a trouvé accidentellement la mort quelque temps après la guerre.
Simone m’a profondément ému et impressionné par sa beauté, son sérieux, ses yeux clairs d’un bleu pur, voilés de tristesse. Sa ressemblance avec ma sœur Erika me la rendait plus précieuse encore ! À son retour, après ses études, Simone est devenue l’épouse d’Antoine Veil, et mère de trois garçons, grand-mère et arrière-grand-mère, ce dont elle est très fière. Simultanément elle a commencé une carrière politique incomparable. En sa qualité de ministre de la Santé, elle a présenté la loi sur l’IVG, donnant aux femmes la liberté de pouvoir interrompre une grossesse non souhaitée. Elle a subi lors de cette mémorable séance à l’Assemblée nationale des affronts inqualifiables. Pour comble, un député conservateur a assimilé son projet à la pratique du génocide nazi. C’était ignoble ! (C’est le moins qu’on puisse dire.) Elle a su, malgré une forte opposition, faire adopter cette loi, qui se trouve encore associée à son nom.
Puis elle est devenue la première présidente du Parlement européen. Après plusieurs fonctions ministérielles, elle a siégé, jusqu’en 2008, parmi les neuf membres du Conseil constitutionnel. Par l’exemplarité de sa vie, elle est, avec quelques autres survivants connus, la preuve incontestable que le monde, dans toute sa diversité, a été privé de la potentialité d’intelligences, d’érudition et de savoir-faire, par le brutal assassinat de femmes, d’hommes et d’enfants, sans autres raisons que celles d’exister et d’être Juif.
Ces propos ne diminuent naturellement en rien notre douloureux souvenir pour les autres victimes de la Shoah pour lesquelles nous gardons toujours une grande place dans notre mémoire. Pour les déportés de France, Simone Veil représente avec dignité et courage le flambeau de la mémoire. Depuis notre retour, nous nous voyons régulièrement, liés par une indéfectible amitié. À chacune de ces rencontres, les souvenirs de là-bas émergent immanquablement. « Nous croyons avoir échappé à Auschwitz, mais nous y sommes toujours. »
Dans les ténèbres de notre existence, dans ce tunnel au bout duquel n’apparaissait aucune lueur d’espoir, il m’est arrivé à Bobrek la chose la plus inattendue : mon premier amour ! C’était un sentiment que je n’avais jamais connu auparavant. Parmi les femmes du commando, une jeune fille a tout particulièrement attiré mon regard. Elle était petite, brune, mignonne et très discrète. J’ai vaincu ma timidité pour lui parler au travers du grillage. Elle s’appelait Bluma Dab et venait d’Anvers. Dès lors elle occupa toutes mes pensées. Ses compagnes nous observaient avec bienveillance, amusées et heureuses pour nous ! Mon amour platonique les attendrissait. Aujourd’hui encore, avec Simone, il nous arrive d’évoquer cette histoire si romantique et surtout les circonstances dans lesquelles elle s’est déroulée.
Un jour Bluma a traversé seule la cour devant l’usine. Sans hésiter j’ai arrêté ma machine et je suis sorti la rejoindre… Inconscients de notre environnement, nous nous promenions ! Le coup de sifflet strident du commandant SS, stupéfait, nous a ramenés à la triste réalité. Il m’a interpellé en hurlant : « Tu te crois où ? Tu es en train de commettre une très grave infraction ! Attends-toi à une sévère punition après l’appel du soir ! » Cet incident s’est finalement soldé par un coup de pied, que j’ai réussi à esquiver. Par bonheur, Lukaschek ce jour-là, contrairement à ses habitudes, n’était pas saoul…
Avec le recul, je réalise que cet amour a fait renaître en moi le goût du « rêve » et de l’espoir. Il m’a été de toute évidence d’un réconfort certain. Avec un morceau de tissu rayé « organisé », je m’étais confectionné un col pour ma chemise et j’avais amélioré la forme de mon béret. Sans doute pour lui plaire et rendre mon aspect plus attrayant. Ces préoccupations vestimentaires n’avaient naturellement pas échappé à mes camarades.
Bluma a survécu. Après la Libération j’ai reçu de ses nouvelles. Elle s’était mariée, avait eu un enfant. Puis curieusement ce fut le silence… Je ne sais pas ce qu’elle est devenue.
De temps en temps, des scènes cocasses et dérisoires se produisaient. Un matin, aux lavabos, je fus témoin d’une parodie inattendue. Quelques déportés, avocats, professeurs, médecins se saluaient en s’inclinant se donnant leur titre respectif :
« Guten Morgen Herr Ingenieur!
– Guten Tag Herr Doktor!
– Gut geschlafen Herr Professor? » (Avez-vous bien dormi Monsieur le professeur ?)
Dans ce monde absurde voulaient-ils se rappeler celui qui était le leur, hier ? se révolter contre l’humiliation et l’anonymat ? ou tout simplement se prouver qu’ils « existaient » encore ! C’était le triste spectacle du passé et des frustrations présentes.
D’autres passaient leur temps de repos à se rappeler les plats succulents préparés par leurs femmes ou leurs mères, échangeant même des recettes. Ils en parlaient avec tant de délectation qu’ils se donnaient l’illusion de les savourer !
Mon voisin de lit, Zev, d’origine polonaise, parlait l’allemand, et nous avions beaucoup d’affinités. Nous sommes devenus amis et le sommes toujours restés.
Durant nos heures de travail et malgré le risque encouru, nous fabriquions des briquets que nous échangions pour de la nourriture avec les civils qui travaillaient avec nous. Bien entendu, notre rendement en pâtissait, mais notre ami Nussbaum, l’ingénieur chargé du contrôle, s’arrangeait pour que le nôtre soit quand même suffisant.
Apprenant, en août 1944, la libération de Paris, nous ne pouvions dissimuler notre joie. Dès lors nous pressentions que des changements allaient bientôt se produire sans toutefois pouvoir imaginer en quoi. Évidemment l’événement le plus souhaité était la victoire des Alliés et l’écrasement du régime nazi. Vers la fin de cette même année, nous entendions de temps en temps, en nous réjouissant, les sirènes annonçant le survol des avions alliés. Mais ni la voie d’accès par chemin de fer, ni les camps d’Auschwitz, considérés par les Alliés comme n’étant pas des objectifs militaires, ne furent bombardés !
Il est certain que ces bombardements auraient entraîné de nombreux morts parmi les déportés, mais en même temps d’une certaine manière une délivrance(5) !
Le jour de Yom Kippour de cette année 1944, j’ai jeûné. Persuadé, quoi qu’il advienne, que ce serait mon dernier Kippour passé au camp ! Le comportement des gardiens à notre égard avait changé. Lukaschek nous a même demandé d’improviser une fête pour le jour de l’an. Éric Altman, né en Allemagne et âgé de 35 ans, fut chargé d’organiser la soirée et le fit avec brio ! Quelle singulière destinée que la sienne ! Dès l’arrivé des nazis au pouvoir, il réussit à quitter Berlin pour la Palestine. En 1939 il vint en vacances en France. Surpris par la guerre, il s’engagea dans la Légion étrangère. Démobilisé après l’armistice, il se trouva dans l’impossibilité de rentrer chez lui et fut déporté en 1942.
La différence d’âge entre nous deux me rendait le tutoiement difficile. Travaillant un jour sur le même chantier, je l’ai interpellé : « Herr Altman… » (Monsieur Altman…) Un SS qui m’a entendu s’est exclamé : « Ici, il n’y a pas de Herr ! Où est-il ? Je veux le voir ! » Éric a reçu deux gifles magistrales, dont il se souvenait après la guerre au point de raconter cette scène avec force détails à ma jeune épouse, quand nous l’avons rencontré à Lyon. Quelle regrettable sottise de ma part d’avoir oublié que nous n’étions plus dans un monde civilisé !
Le soir du 31 décembre 1944, devant un parterre de SS assis, impeccables dans leurs uniformes, et derrière eux nos camarades curieux et anxieux à la fois, fut présenté le spectacle, quelque peu surréaliste ! Éric a commencé le programme par une petite histoire fort téméraire et, avec son accent berlinois légèrement accentué, il fit preuve de courage :
« Un moineau, perché sur un arbre, grelottait, mourant de froid et de faim. Lorsqu’un cheval laissa tomber une crotte bien chaude. Tout heureux le moineau s’y précipita, se mit à picorer, à se réchauffer et commença à gazouiller et à pépier. Un épervier l’apercevant, vola vers cette proie et la dévora. L’histoire a plusieurs morales :
- Celui qui te met dans la merde n’est pas fatalement un ennemi !
- Celui qui t’en sort n’est pas fatalement un ami !
- Mais il est certain que, quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne faut pas chanter ! »
Curieusement il n’y a eu aucune réaction de la part de nos gardiens. Cependant cette histoire, devenue un classique depuis, dite face à des SS est probablement unique dans les annales de la déportation !
Zev et moi avons chanté en hébreu : « Baa menu’ha léagéa… » (La sérénité viendra pour les combattants épuisés…) Fort heureusement la traduction ne fut pas demandée. Gilbert Michlin, un de nos amis, a récité par cœur la fameuse tirade d’Harpagon (personnage de l’Avare de Molière). Le « spectacle » s’est poursuivi dans un calme peu coutumier de nos gardiens. Se sont-ils seulement rendu compte que cette manifestation prouvait combien notre moral s’était amélioré ?
(1) Les phylactères sont deux petits cubes renfermant un morceau de parchemin sur lesquels sont inscrits les versets de la Torah, que les juifs pratiquants attachent l'un au front, l'autre au bras gauche lors des prières du matin.
(2) Le tatouage est interdit par la religion juive (Lévitique XIX, 28)
(3) Dans le langage spécifique des camps, les Allemands possédaient un riche vocabulaire d’insultes et jurons, battus en cela par les Russes et les Polonais ! Faut-il se plaindre de l’indigence française dans ce domaine ?
Une fois de plus je pense à Henri Heine, qui arrivé la première fois à Paris écrit avec ironie à un ami, qu’ici, à l’inverse :«Un seul mot peut désigner en français deux personnages différents, ainsi nous disons »Madame » seulement aux femmes issues de l’aristocratie, alors qu’à Paris je dis «Madame » même à ma concierge!.»
(4) Le terme « organiser » englobait toutes les formes de débrouillardise, le chapardage, le troc, etc. Ce sens se développait après un certain temps de présence au camp et était indispensable pour prolonger un peu sa durée de vie.
(5) Samson Hagibor (Bible), rendu aveugle par la trahison de sa femme, et prisonnier de ses ennemis, demandait à Dieu de lui rendre pour une fois encore sa force perdue afin de pouvoir ébranler les colonnes du palais auxquelles il était attaché, quitte à mourir en même temps que les Philistins, ses ennemis.